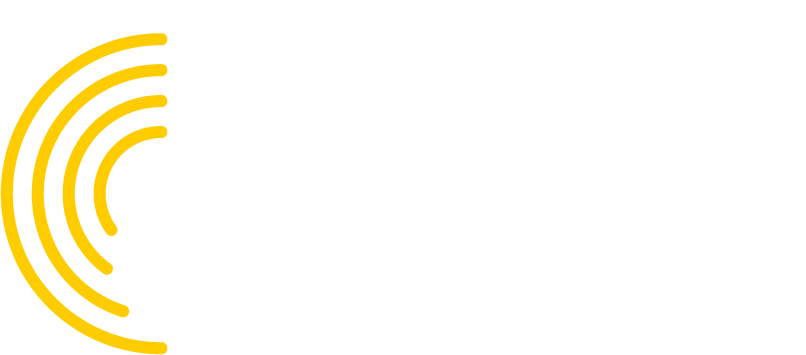Les élections municipales concerne les 34 950 communes françaises, en métropole comme dans les DOM-TOM. Parmi elles, la grande majorité, près de 34 000, comptent moins de 10 000 habitants.
Ces petites communes regroupent 36 millions d’habitants, soit 53 % de la population française, et couvrent environ 90 % du territoire national. Les 950 autres communes, plus grandes et plus denses, concentrent quant à elles près de 32 millions d’habitants sur à peine 10 % du territoire.
Les élections municipales, c’est environ 900 000 candidats et candidates qui se préparent à s’engager pour leur commune, qu’il s’agisse de petits villages ruraux ou de grandes métropoles, pour désigner les 460 000 élus municipaux à travers la France.
Au-delà du choix du maire élu, cette élection détermine la composition des conseils municipaux et intercommunaux, chargés de gérer des compétences essentielles : urbanisme, écoles, transports, logement, environnement, culture ou encore transition écologique.
Véritable acteur du quotidien de millions de français, les élus locaux influencent directement la qualité de vie, le fonctionnement des services publics et les politiques locales.
Les municipales 2026 c’est aussi l’occasion de reprendre la main sur la démocratie : des listes citoyennes et participatives se lèvent partout en France pour faire de la politiquement radicalement autrement, en organisant une démocratie directe où chaque voix compte vraiment.
Dates des élections municipales 2026
Voici les principales dates d’ici aux élections :
- Début période de campagne officielle : 1 septembre 2025
- Date limite d’inscription sur les listes électorales : 6 février 2026
- Dépôt limite de dépôt des candidatures pour le premier tour : 26 février 2026
- Premier tour : 15 mars 2026
- Deuxième tour : 22 mars 2026
Qui peut voter aux municipales ?
Pour voter aux élections municipales de mars 2026, il faut :
- être âgé d’au moins 18 ans,
- être de nationalité française, ou ressortissant·e d’un autre État membre de l’Union européenne résidant en France,
- être inscrit·e sur les listes électorales de la commune.
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous pouvez effectuer la démarche en ligne sur Service-Public.fr, en mairie ou par courrier en joignant un justificatif d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Pas sûr d’être inscrit ?
L’inscription se vérifie facilement en ligne sur Service-Public.fr, en cas de déménagement ou de changement d’état civil, il vous faudra mettre votre situation avant le 6 février 2026 pour pouvoir voter dans votre commune pour les élections de mars 2026.
Pas disponible le jour j pour voter ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez établir une procuration : elle permet de désigner un·e électeur·rice inscrit·e dans la même commune pour voter à votre place, à faire en ligne sur maprocuration.gouv.fr.
Le mode de scrutin aux municipales
Le mode de scrutin municipal français trouve son origine dans la Révolution Française, avec la loi du 14 décembre 1789 qui crée les communes et organise les premières élections municipales le 24 janvier 1790. À l’époque, le suffrage est censitaire, réservé aux citoyens les plus aisés, puis devient universel masculin en 1848 et mixte seulement en 1944 avec le droit de vote des femmes.
Jusqu’à la loi du 19 novembre 1982, les élections municipales françaises reposait sur un scrutin majoritaire intégral : la liste arrivée en tête remportait tous les sièges, laissant aucune place aux minorités locales. Ce modèle, hérité de la tradition jacobine et centralisatrice française, privilégiait la « stabilité » du pouvoir au détriment de l’expression d’une diversité de points de vue.
La réforme de 1982 a introduit une proportionnelle partielle avec prime majoritaire, afin de garantir la stabilité des majorités locales tout en ouvrant le conseil municipal aux courants minoritaires. Cette réforme, portée par le gouvernement de François Mitterrand dans le cadre de la décentralisation, répondait à la volonté de rompre avec un système trop centralisé et de rendre les conseils municipaux plus représentatifs du pluralisme politique local.
Ce choix reste toutefois plus centralisé et majoritaire que dans la plupart des pays européens, comme l’Allemagne ou la Finlande, où les élections municipales se déroulent selon un scrutin proportionnel intégral, permettant à toutes les listes d’obtenir des sièges en fonction de leur score, favorisant ainsi une culture du compromis et de la coopération dans la politique locale.
Le mode de scrutin municipal aujourd’hui
Dans toutes les communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants, les élections municipales se déroulent désormais au scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire.
-
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, elle reçoit la moitié des sièges à pourvoir.
-
Les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
-
En cas de second tour, seules les listes ayant recueilli au moins 10 % des voix peuvent se maintenir, et celles ayant obtenu au moins 5 % peuvent fusionner avec d’autres listes.
-
Le panachage (rayer ou ajouter des noms) n’est plus autorisé : toute modification rend le bulletin nul.
-
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les listes peuvent toutefois être incomplètes, dans la limite de deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir.
Comment se présenter aux municipales : créer une liste électorale
Les conditions d’éligibilité
Pour être candidat·e aux élections municipales, il faut :
- Être âgé d’au moins 18 ans ;
- Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
- Être inscrit sur les listes électorales de la commune ;
- Ne pas être frappé d’une inéligibilité légale (condamnation, incompatibilité de fonctions, etc.).
Le nombre de colistiers requis
Le nombre de conseillers municipaux varie selon la taille de votre commune, mais cette information n’est pas toujours simple à trouver. C’est pourquoi Fréquence Commune a créé un outil pratique pour vous aider à connaître facilement le nombre de candidats à présenter : calculette du nombre de candidats aux élections municipales dans ma commune.
Attention ! À compter des élections municipales de 2026, les communes de moins de 1 000 habitants seront soumises au même mode de scrutin que celles de 1 000 habitants et plus, c’est-à-dire un scrutin de liste sans panachage (rayer ou ajouter des noms n’est plus autorisé), fondé sur des listes paritaires, qui peuvent toutefois être incomplètes dans la limite de deux candidats.
Les règles de parité
Depuis la loi du 6 juin 2000, les listes doivent respecter une alternance stricte femme/homme. Toute liste ne respectant pas cette règle est irrecevable.
L’objectif est de garantir une représentation plus équilibrée dans la vie politique locale.
Encore aujourd’hui, cette inégalité sexiste perdure : près de 82,5 % des maires élus en 2020 sont des hommes. Pour mieux comprendre ces inégalités de genre liées à la politique et s’organiser pour les atténuer, lisez notre analyse « Féministiser la politique », page 179 de notre rapport Prendre le pouvoir pour le partager.
Les étapes pour constituer et déposer une liste
- Former une équipe : réunir des habitants motivés, représentatifs de la diversité du territoire (quartiers, âges, professions, engagements associatifs), créer un collectif qui s’écoute et apprend à travailler ensemble et construit le programme avec les autres habitants.
- Choisir un nom de liste et une tête de liste (souvent futur maire en cas de victoire).
- Rédiger une déclaration de candidature collective (formulaire CERFA n°14997*03).
- Vérifier les pièces justificatives de chaque candidat :
- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
- Attestation d’inscription sur une liste électorale
- Justificatif de domicile ou d’attache fiscale dans la commune
- Attestation sur l’honneur de non-condamnation et d’éligibilité
- Déposer la liste à la préfecture ou sous-préfecture dans les délais légaux (26 février 2026).
- Faire campagne : diffuser le programme, organiser des réunions publiques, aller à la rencontre des citoyens.
L’importance des listes citoyennes et participatives
Qu’est-ce qu’une liste citoyenne et participative ? C’est un collectif d’habitant·es qui s’organise dans sa commune, déterminé à prendre le pouvoir pour le partager. Son programme est co-construit avec les habitant·es, et la liste fonctionne en gouvernance partagée, sans chef.
Inspirées par le communalisme, les listes citoyennes et participatives font de la mairie un outil au service des habitant·es, en soutien des initiatives citoyennes, artisanales, commerçantes, associatives et locales qui font vivre le territoire et ont la capacité de le transformer.
Elles affirment que la démocratie directe ne peut exister sans plus d’égalité politique entre toutes et tous. Elles se retrouvent ainsi autour des mêmes aspirations : protéger le vivant, renforcer la solidarité, lutter contre toutes les formes de discriminations et résister à la montée du fascisme.
Si vous souhaitez agir concrètement pour votre commune, rejoignez une liste citoyenne existante ou constituez la vôtre. Les élections municipales sont avant tout un moment de démocratie locale, où chaque habitant peut devenir acteur du changement dans sa commune, pourquoi pas vous ?
Les candidats et programmes des municipales 2026
Des programmes et candidats qui varient selon chaque commune
Les élections municipales reposent sur des enjeux locaux : chaque commune a ses propres priorités selon sa taille, sa population et son environnement.
Les listes et programmes varient donc fortement d’un territoire à l’autre : certains candidats sont soutenus par des partis politiques, mais la grande majorité se présentent comme indépendants ou sans étiquette, parfois en préférant dissimuler leur affiliation partisane plutôt que de l’assumer ouvertement.
Enfin, de plus en plus de communes voient émerger des listes citoyennes et participatives, portées par des habitant·es souhaitant renouveler la vie politique locale.
Où trouver l’information ?
Pour s’informer sur les candidats et leurs programmes, plusieurs sources sont accessibles :
- Les sites internet et réseaux sociaux des listes candidates, qui publient le programme et la composition de l’équipe.
- Le site de la mairie ou les panneaux électoraux officiels, où sont affichées toutes les listes en lice.
- La presse locale, qui propose souvent des comparatifs ou des interviews.
- Les réunions publiques, débats et rencontres citoyennes, qui permettent de poser directement vos questions aux candidats.
Comment analyser un programme municipal
Chaque programme municipal reflète une vision du territoire et des priorités différentes. Pour bien l’analyser, il ne suffit pas de lire les promesses : il faut comprendre la logique qui le sous-tend et voir si elle répond vraiment à vos besoins quotidiens.
Mais le plus important reste de se faire confiance et de partir de ses propres besoins : qu’attendez-vous vraiment de votre commune ? Quels sujets comptent le plus pour votre quotidien ?
Regardez aussi comment le programme a été construit : a-t-il été élaboré par quelques politiciens, ou résulte-t-il d’un travail ouvert largement aux habitants ?
La méfiance peut parfois être saine : un candidat qui cumule les mandats ou qui a déjà exercé des fonctions locales pendant de longues années change rarement de politique, malgré de beaux discours de campagne.
Les élections municipales sont aussi l’occasion d’aller à la rencontre directe des candidats, de leur poser des questions, d’échanger sur vos attentes et de vous faire votre propre opinion à partir de ces échanges.
Le rôle du conseil municipal et du maire
Le cadre légal
Le conseil municipal est l’organe délibérant de la commune. Élus pour six ans, ses membres votent le budget, créent et gèrent les services publics locaux, décident des projets d’aménagement et fixent les orientations politiques de la commune.
Le maire, élu par le conseil lors de sa première séance, est à la fois chef de l’administration communale et représentant de l’État : il exécute les décisions du conseil, signe les actes administratifs, dirige les services municipaux et veille à la sécurité et à l’ordre public.
Un pouvoir souvent concentré entre les mains du maire
En pratique, le pouvoir communal est souvent très centralisé autour du maire. Si le conseil municipal vote les décisions, la plupart sont préparées en amont dans des commissions internes ou des réunions de majorité. Le maire fixe très souvent l’ordre du jour et dispose d’un rôle déterminant dans leur adoption.
Il dispose aussi du pouvoir d’attribution des délégations confiées aux autres élus adjoints ou conseillers municipaux (urbanisme, finances, culture, etc.). Il a également le pouvoir de retirer les délégations quand il le souhaite, ce qui s’accompagne aussi de la perte des indemnités correspondantes. Ainsi, un conseiller municipal qui s’oppose à la ligne du maire s’expose à être écarté des responsabilités locales et à la perte de son indemnité.
Des alternatives : vers des communes plus démocratiques
Certaines communes participatives, issues des listes citoyennes qui ont gagnées en 2020, expérimentent un fonctionnement municipal plus collectif : le maire y partage ses prérogatives avec un collège d’élus, et les agents municipaux, habitants et associations sont associés aux décisions.
Ces expériences cherchent à rompre avec le modèle représentatif trop vertical, pour tendre vers une gouvernance locale plus démocratique.
Pour mieux comprendre ces nouvelles organisations interne des mairies issues des listes citoyennes et particiaptives, lisez notre analyse « Démocratie interne : organiser le partage du pouvoir », page 29 de notre rapport Prendre le pouvoir pour le partager.
Combien touchent les maires, adjoints et conseillers ?
Le temps et l’investissement des élus locaux
Exercer un mandat local demande beaucoup de temps : un maire travaille souvent à temps plein dans une petite commune, et jusqu’à 60 à 70 heures par semaine dans une grande ville. Un adjoint consacre en moyenne un à deux jours par semaine dans une petite commune, et presque un temps plein dans une grande. Un conseiller municipal, quant à lui, participe à quelques réunions par mois dans une petite commune, et jusqu’à un à deux jours par semaine dans une grande.
À cela s’ajoutent les réunions en soirée, réunions de travail, commissions ou conseils municipaux ainsi que les événements du week-end, matchs sportifs, commémorations ou cérémonies, qui relèvent du rôle de représentation du maire et de son équipe auprès des habitants et des acteurs locaux, un rôle qui pourrait parfois être questionné tant il est chronophage pour les élus et surtout symbolique.
Pourquoi indemniser les élus locaux ?
Il est naturel et essentiel de valoriser cet engagement en indemnisant correctement les élus locaux, afin que s’engager ne soit pas un privilège réservé aux retraités ou aux plus aisés, mais une possibilité réelle pour toutes et tous les citoyens.
Ces montants sont fixés en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, peuvent être modulés par délibération du conseil municipal et sont plafonnés en cas de cumul de mandats.
La loi ne permet aucune différence de traitement entre les élus d’un même rang au sein d’une commune : tous les adjoints perçoivent la même indemnité, et de même, tous les conseillers municipaux touchent un montant identique fixé par délibération du conseil.
Les indemnités des maires
Au 1er janvier 2024, un maire d’une commune de moins de 500 habitants percevait en moyenne 1 048 € par mois, tandis que celui d’une commune de plus de 100 000 habitants percevait en moyenne 5 960 € par mois.
Les indemnités des adjoints
Les adjoints au maire, qui assistent le maire dans la gestion quotidienne, gèrent leur propre délégation, c’est-à-dire un domaine de compétence confié par le maire, comme l’urbanisme, l’éducation ou encore la culture, et représentent la commune en son absence. Ils perçoivent une indemnité variant en moyenne de 250 € par mois dans une commune de 500 habitants, à 900 € dans une commune de 10 000 habitants, et jusqu’à 2 300 € dans une grande ville.
Les indemnités des conseillers municipaux
Les conseillers municipaux, qui travaillent sur certains dossiers avec les adjoints et le maires, participent aux délibérations et votent les décisions du conseil, reçoivent une indemnité plus modeste : non versée dans la plupart des petites communes, autour de 150 € par mois dans une commune de 10 000 habitants, et environ 1200 € dans les grandes villes.
Statut de l’élu : limites et effets du système actuel
Les indemnités des élus sont imposables et soumises à cotisations sociales ; elles ouvrent ainsi droit à la protection sociale et à la cotisation retraite pendant le mandat. En revanche, elles n’ouvrent pas droit au chômage, ce qui rend la reconversion difficile à la fin du mandat, surtout pour les maires et adjoints qui y consacrent la majeure partie de leur temps. Il est ainsi souvent plus simple de se représenter, notamment pour continuer à percevoir ses indemnités, ce qui favorise le carriérisme politique et constitue l’un des biais structurels du fonctionnement représentatif actuel.
Ce biais entraîne une moindre rotation des élus, une sous-représentation des actifs et des profils précaires (voir l’analyse de « Démocratiser la politique ») et alimentant une compétition entre les professionnels de la politique qui favorise parfois les plus opportunistes, au détriment de personnes compétentes et engagées qui pourraient pourtant devenir d’excellents élus.
Conséquences et enjeux des municipales 2026
Un rendez-vous clé
- Les élections municipales sont bien plus qu’un simple scrutin local : elles déterminent la façon dont nos communes seront gouvernées pendant les six prochaines années.
- Elles influencent directement la qualité des services publics, la gestion de l’espace, des logements et des modes de transports, le soutien à la vie sociale et culturelle.
- Les maires et les conseils municipaux forment la base de la République représentative et leurs décisions pèsent tout autant sur notre quotidien que celles du gouvernement national.
Des choix qui structurent notre vie quotidienne
Pour mieux saisir le rôle concret d’une commune ou d’une intercommunalité, on parle de leurs « compétences ». Voici un classement de ces compétences, organisé selon l’ordre d’importance des besoins humains fondamentaux qu’elles visent à satisfaire :
Besoins vitaux : boire, se nourrir, se loger et vivre dans un environnement sain et sûr
- Eau potable et assainissement : gestion des réseaux, stations d’épuration, contrôle de la qualité de l’eau.
- Alimentation locale : organisation de marchés, soutien aux circuits courts, produits locaux dans les cantines.
- Logement : construction de logements sociaux, rénovation thermique, lutte contre les logements vacants ou insalubres.
- Environnement et santé publique : plantation d’arbres, création d’espaces verts, lutte contre les pollutions sonores ou atmosphériques.
- Gestion des déchets et propreté publique : collecte sélective, recyclage, déchèteries, propreté des rues.
- Sécurité civile et prévention des risques : plan communal de sauvegarde, alerte météo, sécurité incendie.
Besoins de sécurité, stabilité et cadre de vie
- Police municipale et tranquillité publique : présence de proximité, prévention des incivilités, sécurité routière.
- Voirie, éclairage public, entretien des espaces publics : réparation des routes, éclairage LED, entretien des trottoirs.
- Urbanisme et aménagement du territoire : plan local d’urbanisme, zones constructibles, espaces verts dans les nouveaux quartiers.
- Cimetières et services funéraires : gestion des concessions, entretien des cimetières communaux.
Besoins sociaux et familiaux
- Petite enfance : crèches municipales, haltes-garderies, soutien aux assistantes maternelles.
- Écoles maternelles et primaires : construction et entretien des bâtiments, cantine scolaire, activités périscolaires.
- Action sociale : aide alimentaire, soutien aux familles en difficulté, accompagnement des personnes âgées ou handicapées via le CCAS.
- Santé et prévention sociale : soutien aux maisons de santé, campagnes locales de prévention, médiation sociale.
Besoins de lien social et d’appartenance
- Vie associative, culturelle et sportive : subventions, mise à disposition de salles, création de clubs et d’ateliers.
- Médiathèques, maisons de quartier, événements locaux : fêtes de village, festivals, rencontres intergénérationnelles.
- Soutien à la vie de quartier et aux initiatives solidaires : jardins partagés, repas de quartier, actions d’entraide.
Besoins d’autonomie, de mobilité et d’opportunités
- Transports publics urbains et intercommunaux : bus, navettes locales, transport à la demande.
- Mobilités douces : pistes cyclables, stationnements vélos, zones piétonnes sécurisées.
- Accès au numérique et inclusion digitale : aide au déploiement de la fibre, formations gratuites à l’informatique.
- Développement économique local : zones artisanales, marchés de producteurs, aides à la création d’entreprise.
Besoins de participation, de sens et d’avenir collectif
- Démocratie locale et participation citoyenne : budgets participatifs, conseils citoyens, réunions publiques ouvertes.
- Transition écologique et énergétique : plan climat, rénovation énergétique des bâtiments publics, soutien aux énergies renouvelables.
- Coopération intercommunale : mutualisation des services, projets de territoire communs entre plusieurs communes.
La majorité de nos besoins fondamentaux, boire, se nourrir, se loger, se déplacer, apprendre, vivre ensemble, sont gérés localement, par les communes et intercommunalités.
De plus, les communes disposent de la clause générale de compétence, qui leur permet de se saisir de tout sujet jugé important par leurs habitants, même s’il n’est pas expressément prévu par la loi, leur offrant ainsi une grande liberté d’action locale.
C’est pourquoi prendre la mairie, c’est aussi reprendre le pouvoir sur nos vies.
Comment fonctionnent les intercommunalités et pourquoi sont-elles essentielles ?
Lors des élections municipales, les citoyens élisent aussi, indirectement, leurs représentants à l’intercommunalité (communauté de communes, d’agglomération, communauté urbaine ou métropole).
Ces structures regroupent plusieurs communes pour mutualiser leurs moyens et gérer ensemble des compétences clés comme les transports, le logement, le développement économique, les déchets ou l’aménagement du territoire.
Dans la plupart des cas, la ville-centre, la plus grande commune de l’intercommunalité, concentre le pouvoir : ses élus disposent d’un poids décisif dans les votes du conseil communautaire. Les compromis entre communes sont nécessaires, mais les grandes villes orientent souvent les choix en matière d’urbanisme, de fiscalité ou de mobilité.
Le fonctionnement des intercommunalités reste souvent complexe et opaque : les compétences sont partagées entre la commune et l’intercommunalité, ce qui rend les responsabilités difficiles à comprendre pour les citoyens. Le jeu politique y est souvent moins visible, alors même que les décisions prises à ce niveau ont un impact direct sur la vie locale.
L’intercommunalité reste un échelon technocratique, dépolitisé et peu démocratique, où les débats sont rares et les décisions souvent prises à huis clos. Les communes participatives y voient une « épreuve » : elles tentent d’y instaurer une gouvernance plus horizontale, résistant à la domination des villes-centres et en favorisant l’implication directe des habitants dans les décisions politiques qu’elles défendent.
Pour en savoir plus lire le passage « L’épreuve de l’intercommunalité », page 249 du rapport de Fréquence Commune.
FAQ – Municipales 2026
Ressources officielles et liens utiles
Pour préparer les élections municipales 2026, plusieurs sites officiels et de référence permettent de s’informer, s’inscrire ou s’engager localement.
Service-Public.fr : site officiel de l’administration française
Pour s’inscrire sur les listes électorales, vérifier son inscription et connaître les démarches liées au vote ou à la procuration.
Maprocuration.gouv.fr : procuration de vote en ligne
Permet d’établir une procuration facilement et rapidement, sans se déplacer.
Ministère de l’Intérieur : Élections
Source officielle sur le déroulement du scrutin, les règles électorales, les candidatures et les résultats.
Vie-publique.fr : Dossier complet sur les municipales 2026
Explications pédagogiques sur le rôle du maire, le conseil municipal et les grandes étapes du scrutin.
Préfectures de France : site des services de l’État
Pour déposer une liste, consulter les résultats officiels ou obtenir des informations locales précises.
Fréquence Commune : Municipales 2026
Plateforme dédiée aux initiatives citoyennes et à la préparation des municipales partout en France.
Actions Communes : réseau de soutien aux listes citoyennes
Ressource collaborative pour accompagner les listes participatives, former les équipes et partager les outils de campagne locale.